A I D E S P E R S O N N A L I S E E S JL GUEGUEN CPC PONTIVY
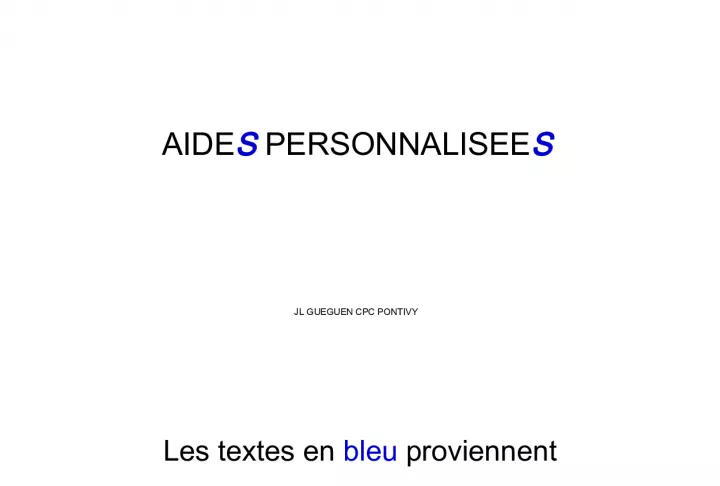

A I D E S P E R S O N N A L I S E E S JL GUEGUEN CPC PONTIVY Les textes en bleu proviennent des ressources du MEN sur lAIDE PERSONNALISEE par
- Uploaded on | 0 Views
-
 jihad
jihad
About A I D E S P E R S O N N A L I S E E S JL GUEGUEN CPC PONTIVY
PowerPoint presentation about 'A I D E S P E R S O N N A L I S E E S JL GUEGUEN CPC PONTIVY'. This presentation describes the topic on A I D E S P E R S O N N A L I S E E S JL GUEGUEN CPC PONTIVY Les textes en bleu proviennent des ressources du MEN sur lAIDE PERSONNALISEE par. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.
Presentation Transcript
1. A I D E S P E R S O N N A L I S E E S JL GUEGUEN CPC PONTIVY
2. Les textes en bleu proviennent des ressources du MEN sur lAIDE PERSONNALISEE parues sur eduscol.education.fr en fvrier 2011
3. 24 heures d'enseignement Organisation de la semaine scolaire 8,10 % des coles ont rparti les 24 heures d'enseignement obligatoire sur 4 jours. 1,9 % des coles les ont rparties sur 9 demi-journes.
4. lves ayant bnfici de l'aide personnalise 322 153 lves des classes maternelles ont t pris en charge, soit 19,73 % de l'effectif dclar. 828 841 lves des classes lmentaires ont t pris en charge, soit 31,80 % de l'effectif dclar. Au total, 1 150 994 lves ont t pris en charge, soit 27,15 % de l'effectif dclar.
5. Rpartition de l'aide personnalise dans la journe Les aides, toutes modalits d'organisation confondues se droulent : en fin d'aprs-midi pour 61,46 % des coles ; pendant la pause mridienne pour 45,10 % des coles ; le matin pour 18,34 % des coles ; un autre moment (formules mixtes) pour 8,14 % des coles ; le mercredi pour 2,68 % des coles.
7. Enseignants d'cole maternelle 29,12 % des enseignants de maternelle conduisent des aides personnalises auprs d'lves de l'cole lmentaire. 70,88 % conduisent des ateliers en petits groupes en maternelle. Sources : enqutes 2009-2010 et 2010-2011 dans l'enseignement scolaire public.
8. Forces et faiblesses du systme ducatif franais * 6 0 % des lves en russite * 15 % des lves en chec * 25 % des lves ayant connu des difficults
9. EVALUATIONS CM2 circonscription PY 2011
10. EVALUATIONS CM2 circonscription PY 2011
11. POUR QUI ? Laide personnalise, pour tous les lves qui en ont besoin Les lves les plus jeunes, ds la petite section , peuvent bnficier dune aide visant stimuler leurs apprentissages lorsquils manifestent un dcalage dans leurs acquisitions, notamment en matire de vocabulaire. Les lves en grande difficult peuvent aussi bnficier de laide personnalise. Sils reoivent par ailleurs dautres aides, dans ou hors de lcole, il faut sassurer quelles nentrent pas en contradiction les unes avec les autres. Organiser leur cohrence et leur complmentarit est lun des rles du projet personnalis de russite ducative (PPRE)
12. La difficult scolaire doit tre apprhende comme un dcalage dacquisition par rapport lun des paliers du socle commun de connaissances et de comptences et non pense comme manifestation dun dcalage par rapport au niveau de production du reste des lves de la classe.
13. Aide aux lves en difficult Reprage Analyse Rponse valuation valuations nationales / Dispositifs dvaluation de classe Individuel et en conseil de cycle dans la classe Rased (dans la classe ou en dehors) Dispositif de mesure des effets de laide apporte Contractualisation quipe pdagogique / lve/ Famille lves besoins particuliers lves besoins particuliers Aide spcialise Stages remise niveau hors 24H Diffrenciation pdagogique Aide personnalise
14. PPS, PPRE ou A.P ? Le PPS ne concerne ques les lves qui ont un dossier MDPH. L aide personnalise sadresse tous les lves en difficult importante ou passagre. Le PPRE concerne les lves en grande difficult et prcise, en regard du socle commun : - les amnagements effectus et les aides apportes en classe - les aides spcialises (RASED, ) - les aides apportes dans le cadre du dispositif dAP
15. Domaines prioritaires Laide personnalise est tourne toute entire, dans le premier degr, vers le franais et les mathmatiques . Cette anne l anglais peut tre aussi concern. Aprs les valuations CM2 avances en mars, les items pourront tre valids jusquen juin.
16. lcole maternelle Trois domaines sont privilgis, parce quils sont les plus prdictifs de la russite dans les apprentissages du cours prparatoire : - le vocabulaire , ds la petite section ; - la conscience phonologique , ds la fin de la moyenne section ; - le dnombrement .
17. Diffrences ou difficults ? A lcole maternelle, les carts dge entre les enfants, donc de dveloppement et de maturit , ont une importance trs forte . Les dcalages entre enfants dune mme section ne doivent pas tre considrs systmatiquement comme des indices de difficult . Ils expriment des diffrences qui doivent tre prises en compte pour que chacun progresse dans son dveloppement personnel. Lcole maternelle a un rle essentiel dans le reprage et la prvention des dficiences ou des troubles, rle quelle doit assumer pleinement, en particulier pour les troubles spcifiques du langage. Prvention mais aussi remdiation
18. Au CP et au CE1 Trois autres domaines viennent sajouter. Ces domaines constituent les composants de base de laccs la lecture et la matrise des nombres : - la comprhension , qui peut tre entrane avant mme de savoir lire et peut donc tre un domaine de laide personnalise ds le dbut du CP, voire en grande section ; - la reconnaissance des mots , qui conditionne laccs au sens et peut tre lobjet daide ds le mois de dcembre du CP ; - la numration , principalement la comprhension et la matrise du systme dcimal.
19. Au CP et au CE1 Elle doit tre souple, volutive et dabord prventive . Lenjeu est dempcher la difficult de sinstaller . Elle doit permettre de construire du sens. Elle renouvelle le regard de lenseignant sur llve et de llve sur les apprentissages dans un climat de confiance.
20. Dmarches Observer llve dans ses procdures de travail, de raisonnement, de prise de parole Analyser les difficults (ou les carts de maturit) pour bien cibler ce qui doit tre fait. Se concerter en cycle pour coordonner lA.P. en articulation avec le travail de classe. laborer lAide personnalise en valorisant : - La prise de parole par llve :explicitation de la situation, de la tche, la verbalisation des reprsentations - Llaboration avec les lves des critres de russite - La manipulation par llve de matriels concrets et doutils varis dans des tches limites nexcluant pas la complexit - Lanticipation dapprentissages venir - La prparation au retour en classes sans A.P.
21. Au cycle 3 La comprhension de lecture doit se poursuivre sur des textes plus complexes et avec des exigences de comprhension plus pousses (infrences). Par ailleurs, laccent est mis sur le domaine de l criture , notamment lorthographe . En mathmatiques , jusqu la fin du cycle 3, la numration et la comprhension du systme dcimal sont privilgis. Les stratgies de rsolution des problmes peuvent galement tre entranes, notamment dans leurs dimensions de comprhension du texte lu et de reprsentation des situations. On veillera galement, pour les lves qui en ont besoin, garantir la connaissance aise des faits numriques (tables, doubles et moitis ).
22. Diffrencier le travail effectu en classe de l AP en : revenant aux fondamentaux, si ncessaire travaillant avec plus de matriel (manipulation) multipliant les interactions entre lves utilisant un support spcifique
23. AU C3, trois types d objectifs envisageables : prvention - anticipation sur l apparition d une difficult venir (rvision, prparation de lactivit...) remdiation - comptence non acquise au cours des annes prcdentes - comptence non acquise au cours d une squence conduite en classe consolidation dune comptence fragile - entranement, travail de la comptence dans un autre contexte
24. Formes de laide personnalise Il appartient aux matres de choisir la modalit la mieux adapte aux besoins des lves concerns, en fonction de lobjectif poursuivi, de la situation particulire du groupe, la frquence et la dure des sances. Laide personnalise peut prendre des formes diverses: - Laide directe lactivit de classe - Laide organise sur une srie de squences - Laide au passage de classe - Laide en programme structur dentranement
25. Laide au jour le jour Cette aide est troitement articule l activit scolaire quotidienne . Cest le droulement de la classe qui dtermine les besoins et le contenu des activits des lves durant le temps daide personnalise. Laide peut consister en une prparation des activits de classe venir ou en une reprise dune partie des activits du jour qui a t mal comprise ou mal russie. Cette forme daide gagne tre conduite par le matre pour un groupe dlves de sa propre classe.
26. Laide organise sur une srie de squences Souvent sur quelques semaines, laide poursuit alors un objectif spcifique . Elle concerne des groupes d lves reprs comme ayant les mmes besoins . Il peut sagir de connaissances ou de comptences non acquises, voire dattitudes cognitives ou scolaires non matrises. Les lves sont regroups sur une base homogne ou htrogne , selon les choix pdagogiques et peuvent tre issus dune mme classe ou de classes diffrentes dune mme cole. Cette aide peut tre conduite par le matre de la classe ou un autre enseignant du cycle ou de lcole.
27. Laide au passage de classe Laide est mise en oeuvre ds le dbut de lanne , surtout en CP et en CE2, au moment du changement de cycle. Elle concerne des lves fragiles , reprs par le matre de la classe prcdente. Laide peut tre conduite par le matre de la classe, celui de la classe prcdente ou un autre enseignant du cycle ou de lcole.
28. Laide en programme structur dentranement Elle se droule sur une dure dune vingtaine de semaines et propose une suite de sances progressives de 30 minutes chacune, en petits groupes homognes. Ces programmes concernent principalement l apprentissage de la lecture en CP ou en CE1 : dcodage,comprhension, rapidit de lecture orale (fluence) sont les principales comptences concernes.
29. Travail en petits groupes Le travail en petits groupes prsente beaucoup davantages pour aider les lves en difficult: - Un espace de travail protg, propice la mise en confiance ( organisation ritualise, rptition ) - Un espace de parole protg (exprimer son point de vue, expliciter sa pense, sa dmarche ,interactions entre les lves) - Un espace propice lobservation de llve au travail - Un espace propice au dveloppement de lattention - Un espace de russite (tches accessibles chaque lve, aide immdiate, dialogue sur lactivit scolaire) Lenseignant permet lenfant de prendre conscience de son rle dcolier, des apprentissages quil fait lcole, facilitant ainsi le rinvestissement dans la classe.
30. Supports de travail En aide personnalise, le premier support de travail de llve est le dialogue personnel entre ladulte et lenfant,moyen de ltayage et de lexplicitation des stratgies. Ladulte peut en effet facilement expliquer et faire expliquer comment et pourquoi faire le travail scolaire demand. Supports matriels Les supports matriels du travail, textes, cahiers, livres , sont rarement diffrents de ceux de la classe. Les tches peuvent tre identiques pour peu quelles permettent rellement lapprentissage.
31. Manipulations : Le petit groupe permet des manipulations , en mathmatiques par exemple, y compris des manipulations dj conduites antrieurement dautres niveaux de classe et que certains enfants ont besoin de refaire pour comprendre une notion. Ressources : Les ressources de l informatique peuvent tre galement mobilises, notamment par les entranements. Mais lactivit des lves avec un programme dentranement informatis ne se limite pas au temps daide personnalis. Elle doit pouvoir se poursuivre, de faon autonome, en classe ou dans la famille, au-del du temps consacr laide personnalise. Jeu : Le jeu nest nullement exclure, mme si, comme cest le cas pour les programmes dentranement informatiss, lobjectif nest pas de faire jouer les enfants pendant le temps de laide personnalise mais de leur apprendre utiliser le jeu pour quils puissent poursuivre des apprentissages au-del du temps consacr laide.
32. Choix du moment et de la dure de laide Le moment de la journe et la dure des sances daide personnalise sont fortement contraints par des contingences extrieures fortes, parfois mme incontournables : transports scolaires, autres activits scolaires, accompagnement ducatif
33. Quand ? Dans toute la mesure du possible, on privilgie les priodes de plus grande vigilance (fin daprs-midi ou fin de matine). Des dures courtes (30 ou 45 minutes) et frquentes (3 ou 4 fois par semaine) sont prfrables des squences longues (une heure ou plus dune heure). Plus les enfants sont jeunes et plus la sance sera brve.
34. Quelle forme ? Lorganisation des sances sera rptitive dans sa forme pour scuriser lenfant et ne pas perdre de temps. Pour un lve donn, la dure hebdomadaire de laide personnalise est de 2 heures , au maximum. Le cas chant, si le besoin est avr, un lve peut bnficier de 2 heures daide personnalise chaque semaine pendant toute la dure de lanne scolaire, soit 2h x 36 semaines .
35. En Aide personnalise VITER AU CONTRAIRE De remplacer la diffrenciation en classe par laide personnalise Conserver ces deux aspects complmentaires Dutiliser le temps daide pour terminer un travail demand en classe Sefforcer de construire un diagnostic des difficults de llve De reprendre lidentique ce qui a chou en classe Sappuyer sur les travaux russis par les lves pour aller vers la complexification progressive Les engagements trop ambitieux et les promesses de russite qui se rvleraient intenables Valoriser les avances mme modestes. Formuler pour les lves, et avec eux, les russites
36. De trop simplifier les tches Utiliser des situations-problmes adaptes De traiter simultanment plusieurs difficults La dispersion savre toujours prjudiciable. Hirarchiser le traitement des difficults De proposer toujours les mmes tches raliser Il faut varier les entres, les stratgies de manire stimuler llve. Un traitement mcanique de la difficult en recourant des exercices systmatiquement Construire le projet avec llve et permettre le recours diffrentes activits
37. Faire avec llve et ses parents
38. LENJEU DU TRAVAIL AVEC LES FAMILLES Faire adhrer la famille la dynamique de laide personnalise est indispensable Il est dterminant de faire comprendre aux parents lintrt des ruptures proposes en leur montrant dans quelle logique, quelle continuit ces volutions sinscrivent. Rapport de lIGN, septembre 2007
39. Pourquoi travailler avec les familles ? 1) Les parents sont membres de la communaut ducative dans les textes rglementaires, ils sont donc lgitimes dans lcole. 2) Crise d angoisse des familles. Les familles sont de plus en plus angoisses pour lavenir de leur enfant. Pour la premire fois depuis des gnrations, aucune famille nest assure que ses enfants vivront mieux quelle. 3) Peur de lcole pour certains parents qui ont pu y tre en chec. 4) Les temps des familles , de lenfant, de lcole, de la ville ne sont pas les mmes. 5) La posture des parents nest pas la mme que celle des enseignants : les uns ont des intrts particuliers, les autres des intrts collectifs. 6) Pas une famille : des familles diversifies, diffrentes Tout enseignant, tout ducateur doit avoir comme ligne daction que tout enfant est capable . 7) Lcole est souvent incomprhensible pour les familles. 8) Dvelopper les relations parents-enseignants, cest utile ! Un plus pour la russite des jeunes ; un plus pour lexercice du mtier enseignant .
40. LES CONDITIONS DU DIALOGUE Limplication, l adhsion de llve et de sa famille laide personnalise sont fondamentales. Le dialogue doit leur permettre de prendre conscience des ATOUTS et des FAIBLESSES de llve. Pour llve , il sagit de confronter le diagnostic port par lenseignant et la perception quil en a. Il est dterminant didentifier dans le dialogue avec llve les domaines sur lesquels il accepte de sengager. Avec les parents, il faut viter les faux changes o en fait en proposant, on impose un projet. Ladhsion de la famille est un lment dcisif du succs de laide personnalise.
41. Le travail de concertation avec la famille a une double fonction Apporter des informations claires sur la situation de llve. tablir une mobilisation de llve et de sa famille
42. Apporter des informations claires sur la situation de llve Il nest pas ais pour des parents de comprendre, danalyser et parfois mme de reconnatre les difficults de leur enfant lcole. Souvent, les difficults de llve ont t signales trs tt aux parents. Mais ce trs tt a cristallis les angoisses, les peurs, a parfois mme entran des rgressions La discussion doit partir des comptences de llve. Suite aux valuations et aux diffrentes observations, le dialogue sinstaure autour des comptences de lenfant : comptences choues mais aussi comptences russies. Laide prend en compte le pass de llve, elle acte la situation prsente sans la figer et surtout elle projette dans le futur. Il est important dviter les jugements de valeurs sur lenfant et sur sa famille.
43. MENER UN DIALOGUE AVEC LLVE Pour llve , il sagit de la confrontation entre le diagnostic port par lenseignant et la perception quil en a. Il est dterminant didentifier dans le dialogue avec llve les domaines sur lesquels llve accepte de sengager. Le dialogue doit lui permettre de prendre conscience de ses ATOUTS et de ses FAIBLESSES.
44. tablir une mobilisation de llve et de sa famille Laide personnalise doit contenir des propositions concrtes avec des objectifs clairement et simplement dfinis. Durant lentretien, les diffrentes tapes ainsi que les enjeux doivent tre bien explicits la famille. Un enfant qui apprend est un enfant valorisant pour la famille. Cest utile aussi de proposer un calendrier de rencontres pour faire le point, y compris si a marche bien et de repartir avec une prochaine date de rencontre. Une vigilance particulire doit tre apporte pour viter: le dcouragement li au sentiment de ne jamais voir lenfant rattraper le niveau ; de se contenter de lobservation des progrs de lenfant par rapport lui-mme, ce qui peut donner lide dune russite immdiate court terme, mais trompeuse moyen et long termes.
45. VALUER LAIDE PERSONNALISE lentre dans laide personnalise, pour valuer les besoins de llve, les ressources mettre en uvre et les objectifs fixer. court terme, en fin de laction spcifique par rapport aux objectifs fixs llve. Ces objectifs sont des objectifs jugs significatifs par rapport lapprentissage recherch et la situation de llve. moyen terme pour voir lefficacit de laction dans le cadre de lacquisition des objectifs du cycle. Ces valuations doivent tre cadres et comprhensibles par llve et sa famille. la fin de la priode de mise en place de laide personnalise, il importe de faire le point sur les comptences acquises par llve au regard des objectifs atteindre en fin de cycle afin que la famille situe clairement les enjeux.
46. Des repres pour laction Le socle sacquiert de manire continue de la maternelle la fin de la scolarit obligatoire Renforce la ncessaire continuit entre les cycles et les degrs Renforce les concertations et le travail en quipe
47. Bien grer lvaluation Lvaluation est un repre pour la construction des apprentissages pdagogiques. Elle doit garder sa JUSTE PLACE. Il faut viter de consacrer plus de temps la vrification des acquis quaux apprentissages eux-mmes.
48. Types dintervention / Temps dintervention Dbut de journe Actions de sensibilisation et de prvention Activits pralables autour de ce qui peut favoriser la russite . Prparation la participation aux temps collectifs. Anticipation sur un apprentissage de la journe . Fin de journe Travail de rappel, de retour rflexif sur les apprentissages, mmorisation . Travail de lattention et de la concentration soutenues . Actions de consolidation. Anticipation sur un apprentissage du lendemain . Pause mridienne Dveloppement de lautonomie et de linitiative . Dveloppement de limagination . Anticipation sur un apprentissage de la journe . Voir document complmentaire
49. Retours des enseignants sur lAP : - Les lves en difficult ont peu dautonomie. - Ils ont des difficults verbaliser. - Les progrs raliss ne se retrouvent pas souvent de retour dans le groupe classe.
50. Comment dvelopper lautonomie et favoriser linitiative des lves ? Comment favoriser la verbalisation tout au long de la tche ? Comment favoriser le transfert des acquis dans le groupe classe ?
51. Les principales capacits attendues dun lve autonome sont les suivantes : sappuyer sur des mthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanment un dictionnaire, une encyclopdie, ou tout autre outil ncessaire, se concentrer, mmoriser) ; savoir respecter des consignes ; tre capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir : - identifier un problme et mettre au point une dmarche de rsolution ; - rechercher linformation utile, lanalyser, la trier, la hirarchiser, lorganiser, la synthtiser ; - mettre en relation les acquis des diffrentes disciplines et les mobiliser dans des situations varies ; - identifier, expliquer, rectifier une erreur ; - distinguer ce dont on est sr de ce quil faut prouver ; - mettre lessai plusieurs pistes de solution ; savoir sautovaluer ; dfinir une dmarche adapte au projet ; prendre des dcisions, s'engager et prendre des risques en consquence ; prendre l'avis des autres, changer, informer, reprsenter le groupe ; dterminer les tches accomplir, tablir des priorits.
52. De faon transversale, quatre ples peuvent tre identifis : 1. Aider llve mieux apprendre 2. Aider llve prendre conscience de ses procdures 3. Quel statut pour un oral construit et pens dans le cadre dune situation dapprentissage ? 4. La posture de lenseignant
53. 1. Aider llve mieux apprendre - Proposer des outils facilitant la mmorisation (reprer les paragraphes de la leon, encadrer les mots cls, lire plusieurs fois une table, la copier - Construire un fichier mthodologique qui prend en compte ce quil y a apprendre (une posie, un rsum,). - Rsoudre mentalement des problmes aux donnes numriques simples. - Elaborer des rgles simples de conduite de classe (pour favoriser la mmoire) : aller directement lessentiel pendant la courte priode dattention (10 minutes par petites phases) ; faire des sances plus courtes suivant lge ; articuler activits orales, utilisation du tableau et manipulations en sachant que les lves ne doivent pas rester sans action plus de 10 minutes apprendre moduler sa voix, jouer avec le silence.
54. 2. Aider llve prendre conscience de ses procdures - Comprendre la consigne apprendre identifier la problmatique. proposer des consignes ouvertes/fermes, orales/crites. Mettre en relation la consigne avec les connaissances apprises antrieurement ( quoi cela peut faire rfrence), les acquis. - Relire la consigne habituer les lves prendre un temps pour relire et examiner les rponses quils fournissent et se poser la question de sa validit. - Reprer des stratgies de rsolution qui permettent la russite. sentraner prsenter des stratgies lors de la correction. inviter anticiper un rsultat, avoir une ide du travail produire pour orienter sa recherche.
55. 3. Quel statut pour un oral construit et pens dans le cadre dune situation dapprentissage ? Mise en place dun entretien dexplicitation face la relation daide, observer llve en train de faire, de dire ; passer du pourquoi au comment (plus dynamisant) ; faire dcrire les procdures ; poser des questions qui ouvrent la communication ( A quoi le vois-tu ? ; Comment le sais-tu ? ; Quest-ce qui te fait dire que . proposer des situations dapprentissage avec dbat argument pour dvelopper les capacits langagires et parvenir un propos oral structur de la part de llve.
56. 4. La posture de lenseignant Quelle rponse face aux sollicitations des lves afin dviter la dpendance ladulte ? prciser ce quon attend des lves ; apprendre identifier les contraintes ; fournir aux lves des occasions de planifier le travail avec une marge dautonomie (slectionner les informations/surligner) ; faire le lien entre les tches proposes au cours dune mme sance (distinguer le travail de recherche, dun travail dapplication), entre les diffrentes sances de laide personnalise (rappel par des traces crites et souvenirs des activits antrieures).
57. COMMENT FAVORISER LA VERBALISATION TOUT AU LONG DE LA TACHE ? Suggestions et relances possibles
58. Travail sur les donnes de lactivit : Perception, vocation et mergence des reprsentations Quest-ce que tu vois ? Quest-ce que cest ? A quoi cela te fait-il penser ?
59. Travail sur les hypothses et les donnes de tche Que pouvons-nous bien faire de a ? Quest-ce que cela nous apprendrait ? Que savons-nous dj faire pour raliser cela ?
60. Recherche de la finalit disciplinaire de la tche propose Que devons-nous faire exactement ? Quapprendra-t-on alors ? A quoi cela peut-il bien servir ?
61. Anticipation sur les conduites cognitives employer et Planification Comment va-t-on sy prendre ? Quest-ce que cela tamne faire ? A quoi faut-il prendre garde ? Quels conseils peux-tu donner ?
62. Temps daction individuelle : Des essais / erreurs vers la comprhension et la russite Que faut-il faire de a ? Quy a-t-il faire ? Que fais-tu ? Quand as-tu fait quelque chose comme a avant ? Comment vas-tu ty prendre ? Vois-tu une difficult qui tattend ?
63. Identification des stratgies mises en uvre dans lactivit Arrte et regarde ce que tu fais. Dis-moi comment tu as fait a. Oui, cest juste mais comment as-tu su que ctait juste ? Quas-tu besoin de faire ensuite ? Que penses-tu quil tarriverait si ? Pourquoi ceci est mieux que cela ? A ton avis quel est le problme ? Peux-tu trouver une autre manire de faire ? O as-tu fait a avant et qui taide rsoudre le problme ?
64. Reprage par lenfant des obstacles notionnels et des comptences cognitives mobilises ou mobiliser Quelle difficult as-tu rencontre ? Que te reste-t-il faire ? Que penses-tu de ton travail ? Vous vous tes aids ? Sur quoi ? Pourquoi ? Que vas-tu dire aux autres ? Est-ce que a peut les intresser, les aider ? Voir document
65. 12 cls pour une AP efficace 1- Choisir les lves En fonction des valuations de classe, nationales,de lobservation,des changes avec les collgues, le RASED, de lintuition 2- Cibler des comptences prcises du programme comptences pour lesquelles les progrs des lves sont rapides et facilement mesurables comptences pour lesquelles les progrs sont vrifiables sur un plus long terme
66. On privilgiera les activits sollicitant fortement lactivit intellectuelle des lves, leur capacits de rflexion . 3- Constituer des groupes cibls Privilgier le groupe de 3 4 lves , pour favoriser interactions, observation fine des procdures. 4- Adopter un rythme soutenable Dans la semaine / Dans la sance Etre attentif aux signes de fatigue , dvitement
67. 5 - Dfinir le type daide Aides prventives : anticiper la difficult - Faire avant les autres, - Dcouvrir le texte avant les autres, - Dcouvrir lnonc avant - Connatre les consignes avant - Dcouvrir le matriel, les supports avant Lenfant en AP a ainsi un temps davance et devient mme une personne ressource . En classe, il va reconnatre ce quil aura dj compris en AP . Aides de renforcement : entranement et automatisation de notions comprises mais non automatises Aides de remdiation : reprises de notions non comprises avec tayage
68. 6- Diversifier les situations/les supports Le jeu Il doit bien rpondre la comptence vise, on vitera de se laisser envahir par le jeu lui-mme. 7- Faire des sances articules, sinon ritualises - Entre dans lactivit ( rappel de ce qui a t fait avant, pourquoi on est l ) - Corps de la sance - Bilan de la sance, synthse. Qua-t-on appris aujourdhui ? - Cahier de llve
69. 8 - Faire fonctionner les outils -Inviter llve utiliser les rfrents prsents dans la classe (affichages, ) pour mieux comprendre, mieux mmoriser, faire des liens. - Rinvestir les outils collectifs et individuels de classe 9 - Changer de posture - Eviter le frontal, le guidage permanent. - Favoriser la dmarche par essais/erreurs, la recherche de solutions par llve. - Analyser les procdures utilises par llve.
70. V-I-P (M. Brigaudiot) V veut dire valoriser. I veut dire interprter. P veut dire poser un cart entre la procdure actuelle de lenfant et, soit celle dun enfant qui serait expert cette tape de lapprentissage, soit celle dun adulte. EXEMPLE Il tait une foua un nocr qui mang bocou les senfans.
71. M. valorise cest vraiment bien parce quil a commenc crire tout seul une histoire. M. interprte Il a crit il tait une en regardant dans le texte de la grande histoire et il a essay dcrire fois en se servant de ses oreilles. Cest trs intressant parce quil a entendu [f] et [u a] et il a crit F qui fait [f], O et U qui font [u] et A qui fait [a]. M. pose un cart : Alors il faut que je vous dise quen franais, quand on entend [wa], on crit toujours les lettres O et I. Voil jcris fois, F, O, I, et je mets un S quon nentend pas : comme dans une fois , parfois , des fois, on met un S fois .
72. 10 - Favoriser explicitation et retour rflexif Diffrer laction car les lves sont sans cesse dans un rapport direct au monde. importance de la verbalisation, des changes pour amener llve : - tre autonome dans la rflexion - prendre conscience de ses procdures 11- Construire le lien entre lAP et la classe Expliquer comment on utilisera le nouveau savoir en classe. 12 - Tisser le lien lves / parents Valoriser les progrs par le dialogue et la collaboration avec les parents. LAP dans ces conditions dveloppe lestime de soi pour llve mais aussi pour les parents.
73. Les cls de lAide personnalise Choisir les lves Cibler des comptences Constituer des groupes cibls Dfinir le type daide Adopter un rythme soutenable Varier les situations Ritualiser les sances Faire fonctionner les outils Changer de posture Favoriser lexplicitation Faire le lien avec la classe Tisser du lien avec la famille
74. Extrait dune intervention de Vronique Boiron Inutile de bricoler pour rendre les activits ludiques ; cela naide PAS les lves en difficult ! Au contraire, moins de fun et plus de zen permet aux lves en difficult de mieux comprendre les enjeux et dentrer dans lactivit demande. Les aider penser. Diffrer laction, car les lves sont sans cesse dans un rapport direct au monde. On met trop vite les lves face la tche. La concentration se fait sur la tche au dtriment de lactivit intellectuelle.
75. TRACES et SUIVI - Prvoir un espace spcifique lAP (petit cahier ou partie de cahier ou de classeur, pas de fiche volante). - Faire apparatre toute activit dcline. Cet espace permet la famille et lenfant : - de prendre conscience de lobjectif - de constater les progrs Il permet aux enseignants : - le suivi pdagogique li lobjectif initial Contrat pour les familles et llve - Communiquer les objectifs de la prise en charge aux familles - Evaluer rgulirement les progrs et les communiquer aux familles
76. Chaque sance : trace systmatique Travaux des lves (le cas chant, ou photo de lactivit) Comptence travaille, crite, pointe, formule par llve (peut-tre sous forme de dicte ladulte, en fin de sance : jai appris ) Quels objectifs assigner lAP pour les lves? - Se construire comme un tre pensant - Comprendre les enjeux des apprentissages scolaires pour soi, pour la collectivit - Comprendre quun savoir est une cl pour dautres savoirs